YULE et Solstice d'hiver : aux origines cachées de Noël
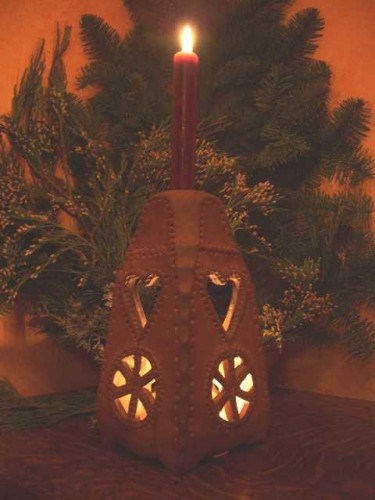
JUL
(ou YULE), le Solstice d'Hiver consacré à Wotan/Odin, arrive à grands
pas. C'est ce Solstice d'Hiver païen qui fut naguère détourné par
l'Eglise chrétienne pour en faire Noël, en le décalant simplement au
24-25 décembre, date à laquelle s'achevaient les Saturnales de la Rome
antique, et où l'on célébra aussi à partir d'une certaine époque Sol Invictus, le Soleil Invaincu, de même que, plus marginalement, la naissance du Dieu Mithra, lui-même divinité solaire.
Cette
tradition ancestrale remonte donc bien au-delà du christianisme, en
dépit des idées reçues. Les rites et festivités liés au Solstice
d'Hiver, qu'ils se rattachent à l'antique tradition romaine ou aux
racines germano-nordiques de la célébration, honorent tous la
renaissance progressive de la lumière et de la vie, à partir du point le
plus obscur de l'année. La période du solstice d'hiver, comprise
approximativement entre le 21 et le 25 décembre, est en effet celle où
la nuit est la plus longue, et le jour le plus court. Il s'agit donc de
célébrer le réveil annoncé de la nature et de la vie, dans le mouvement
cyclique des alternances entre la mort et la vie, la rotation éternelle
du cycle des saisons, symbolisée notamment par la roue solaire.
A vrai dire, le nom même de Noël est une altération d'une autre désignation de cette fête païenne : la Neue Helle,
autrement dit la "Nouvelle Clarté". Elle marque donc le début, à partir
du Solstice d'Hiver, d'un lent processus de renouveau de la lumière,
des forces de la vie et de la Nature endormies, le soleil commençant
très progressivement à briller chaque jour un peu plus longtemps à
compter de cette date. Certains auteurs, tels que le très estimable
Alain de Benoist dans son ouvrage Fêter Noël, ont pour leur part proposé une autre étymologie du nom français Noël, en le faisant dériver du latin natalis, et en l'apparentant donc à l'italien Natale et au provençal Nadal,
qui désignent explicitement la "Nativité". Cette théorie linguistique
apparait néanmoins pour le peu hasardeuse, pour ne pas dire douteuse, et
ne résiste guère à la comparaison avec celle qui fait dériver le mot de
la Neue Helle, nettement plus plausible et convaincante.
C'est
dans cette même optique de célébration de l'espoir de la renaissance
que se sont popularisées via les traditions germano-nordique comme
romaine les décorations à base de branches et de feuilles de houx, de
sapin, ces plantes qui demeuraient toujours vertes et qui incarnaient
donc le renouveau à venir. Les couronnes de l'Avent, constituées de
branches vertes tressées en forme de cercle, participent de la même
symbolique, représentant la plante qui reste verte associée au cercle du
cycle des saisons et des renaissances, véritable forme simplifiée de la
roue solaire, en l'honneur du soleil invaincu et renaissant.
Procède
aussi bien entendu du même symbolisme païen l'arbre de Noël, tradition
évidemment héritée des anciens usages germaniques et nordiques, tout
comme celle de la bûche, qui se rapporte aux anciennes célébrations du
Solstice d'Hiver, par rapprochement entre le feu et le soleil à
renaître. Le sapin, en sus d'être toujours vert et d'incarner les
principes de vie et de renaissance, s'apparente aussi à l'Irminsul des anciens Germains continentaux, ainsi qu'à l'Yggdrasil des anciens Scandinaves. Il est arbre de vie et axis mundi, axe du monde qui soutient et relie les divers plans de l'univers.
Le
sapin de Noël se fait ainsi image de l'arbre cosmique, et s'inscrit
donc dans une représentation du sacré dont le sens échappe aujourd'hui
au plus grand nombre.
Quant
à la figure mythique du Père Noël, si chère à l'imaginaire enfantin,
elle est en fait issue d'un subtil mélange entre trois personnages
mythologiques : le dieu Wotan/Odin, la déesse Freyja, deux divinités
pourvoyeuses symbolisant l'abondance et la fertilité, et le Saint
Nicolas chrétien, lui -même constituant une figure pourvoyeuse d'origine
païenne.SUITE
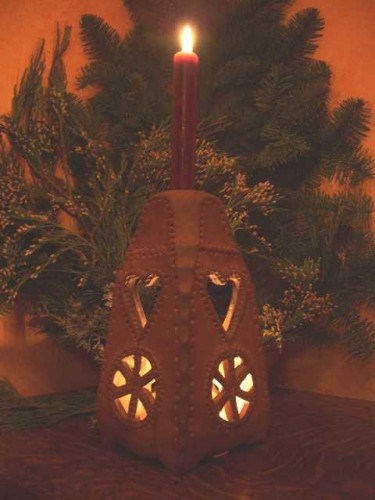
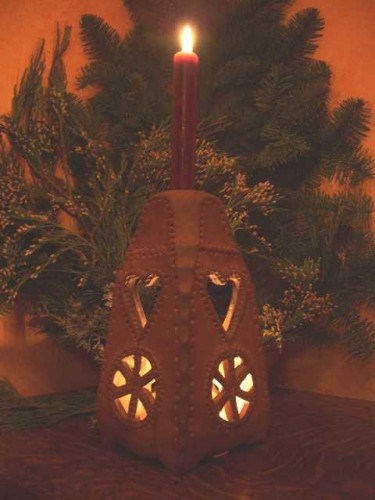
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire